Emily ou la déraison
Editions Grasset. 2008.
Première page
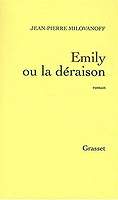
Dans les premières années de l’après-guerre, ma famille s’était regroupée à Belle Ombre, une grande maison de maître à deux étages, située au sud de Nîmes, en pleine campagne. C’est là que s’est formé le noyau primitif de mes sensations sous le regard fantasque d’une tribu où les femmes dominaient. Nombreuses sont les heures du passé qui ne trouvent pas où s’inscrire. Le privilège ou la malédiction de ma mémoire est de pouvoir les rattacher à un lieu unique, composé d’une ancienne bastide et d’un parc à l’abandon. Pour ramener un peu de la poussière des jours enfuis, il me suffit de visiter par la pensée la haute bâtisse aux murs lépreux engloutis sous le lierre noir qui montait jusqu’à la toiture. Derrière chaque porte, au fond de chaque couloir, dans chaque chambre, il y a les masques que j’ai portés et que j’ai retirés ce soir de juin où, après avoir vérifié avec Emily que nous n’avions rien oublié dans les dix-sept pièces vides, j’ai claqué derrière moi la lourde porte de chêne noircie, en laissant allumées toutes les lampes.
Je me revois quittant le parc au volant de la DS verte et beige à toit ouvrant, avec ma sœur qui tenait une cruche d’argile sur les genoux et qui disait, j’ai ramené ce botijo d’Andalousie, il est ébréché mais c’est un nounours borgne pour moi, pas question que je l’abandonne. Des phrases pareilles, Emily était capable d’en proférer des dizaines dans la journée et l’on n’y prêtait pas attention, pas plus qu’on ne s’inquiète des éclairs de chaleur sur la mer dans un ciel d’été sans nuage. C’est plus tard, quand les mots insensés ont fait place à des actes de même nature, que l’on s’est rappelé les images qui fouettaient - et souvent saccageaient - sa conversation.
- Je suis triste d’abandonner la maison avec tous les Noëls qui sont dedans et Père qui chante des chansons russes et tante Odine qui se taille le poignet en ouvrant les huitres et Rosanna qu’on entend gémir, « mais si tu m’avais laissé faire ! Si tu m’avais laissé faire ! ».
Jusqu’au péage de l’autoroute, Emily avait continué de s’agiter et de divaguer et de protester parce que les nouveaux propriétaires de la maison, qui vivaient au Venezuela, nous avaient forcés à partir en nous menaçant d’un procès. Elle déclara que c’était injuste de laisser Père chanter tout seul dans une langue que personne ne comprenait à part les bonhommes de neige et les lents moujiks au nez rouge, et que nous étions criminels, nous les enfants et les héritiers des vieux Noëls, d’abandonner Rosanna à ses tricots et de ne rien faire pour empêcher tante Odine de se vider de son sang. Je tentai de la consoler de mon mieux en lui décrivant la vie qui nous attendait à Paris et les distractions qu’elle y trouverait. Elle se calma peu à peu, reprit confiance, s’intéressa aux collines de chênes-verts que nous traversions ou aux voitures qui nous suivaient, puis, sur une remarque impartiale que je lui fis à propos du laisser-aller de sa coiffure, elle sortit une minuscule trousse de la boîte à gants, abaissa le pare-soleil pour se regarder dans la glace rectangulaire et se maquilla, se peigna, se passa les paupières au crayon noir en déclarant que j’étais beaucoup plus qu’un frère pour elle, un gardien, un rempart, un bouclier. A l’évidence ce dernier mot lui plaisait particulièrement, elle le répéta d’une voix de plus en plus faible, pour elle-même. Je savais que c’était bon signe quand elle prenait soin de son apparence et restreignait le champ illimité de son angoisse à des problèmes de toilette ou de cosmétique. Je préférais la voir s’inquiéter de son teint brouillé par l’insomnie ou d’un bouton apparu près de sa lèvre plutôt que de l’entendre parler des morts de la famille comme s’ils avaient été entassés sur la banquette arrière de la DS.
|